Biochimie
LES ECHANGES TRANS-MEMBRANAIRES
Plusieurs processus règlent les transports trans-membranaires. ils sont dit actifs ou passifs selon qu'ils utilisent l'énergie de la cellule ou non. De plus, il y a une sélectivité de perméabilité selon la taille des molécules, la charge ionique ou la concentration de part et d'autre de la membrane, ce qui mettra en jeu de nombreuses protéines structurales membranaires appelée : protéines de transport membranaire.
1. Répartition ionique
La membrane maintient des concentrations différentes d'ions et de protéines entre le milieu intra et extra cellulaire.
Le cation majoritaire du jnilieu extracellulaire est le Na+, et celui du milieu intracellulaire
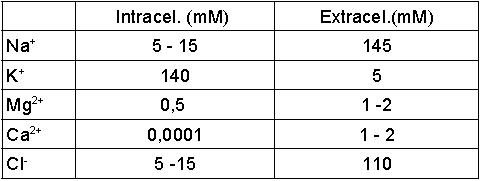
Bien que le cytosol et le milieu extracellulaire soit électriquement neutre, il existe un léger excès de charges négatives près de la face interne de la membrane, dû à des protéines, et un léger excès de charges positives sur la face externe. Cela génère une différence de potentiel entre les membranes appelée potentiel de membrane allant de -100mV à -20mV selon les cellules.
Rq: le signe - indique que l'intérieur de la mb est négatif par rapport à l'extérieur.
Le gradient chimique et électrique entre les 2 faces correspond au gradient électrochimique.
2. Transport Passif
La Diffusion Simple
Elle ne concerne que les molécules liposolubles (hydrophobe) et les petites molécules polaires non
chargées (eau, gaz respiratoires, NHs, stéroïdes, vit ADEK, urée, glycérol...) qui peuvent traverser
directement la double couche phospholipidique.
Doit respecter le sens de leur gradient de concentration (cad du plus concentré vers le moins
concentré). Elle respecte la première Loi de diffusion de Fick selon laquelle une substance diffuse dans
la direction qui tend à éliminer son gradient de concentration avec une vitesse proportionnelle à
l'importance du gradient.
Elle ne nécessite l'intervention d'aucune protéine.
Elle n'est pas saturable tant que l'équilibre n'est pas atteint.
Cas particulier de l'eau: phénomène d'Osmose
Rappel:
Durant l'Osmose, l'eau, qui est considérée comme un solvant, traverse sélectivement une membrane
perméable (ex mb plasmique) pour aller du milieu hypotonique (le moins concentré mais le plus dilué)
vers le milieu hypertonique (le plus concentré donc le moins dilué). En fait l'eau cherche à diluer le milieu
hypertonique jusqu'à atteindre un équilibre de part et d'autre de la membrane. L'osmose ne nécessite
aucune énergie et ne concerne que les déplacements d'eau.
Ex: Hématie plongée dans un milieu hypertonique → le GR se déshydrate
Hématie plongée dans un milieu hypotonique → le GR gonfle et se lyse
La Diffusion Facilitée
La diffusion facilitée intéresse les ions et les molécules chargées, non liposolubles et donc incapable de
traverser la mb phospholipidique (glucose...).
Ne nécessite pas d'énergie, car elle respecte le gradient de concentration.
La diffusion facilitée est plus rapide et plus efficaces que la diffusion simple.
Elle utilise obligatoirement des protéines structurales donc
1 - spécificité protéines de transport / substrat
2 - phénomène saturable
3 - possibilité d'inhibition compétitive
4 - possibilité d'inactivation chimique
Ce type de transport peut être décrit par une séquence cinétique en 4 étapes: liaison, transport,
dissociation, retour à l'état initial. Les étapes 1 et 3 sont similaires à la reconnaissance d'un substrat et à
la libération du produit par une enzyme.
On donne différent nom au transporteur:
Uniport: ne transporte qu'une molécule dans un sens donné.
Symport: transporte 2 molécules simultanément dans le même sens.(cotransport).
Antiport: transporte 2 molécules simultanément en sens opposés, (cotransport).
Dans le cas d'un transport d'ion, on dit qu'il est:
Electroneutre: s'il y a simultanément neutralisation de charges, soit par symport d'ions
chargés de signe opposé, soit par antiport d'ions de même charge.
Electrogénique: si le processus de transport aboutit à une différence de charges
de part et d'autre de la membrane.
L'études des ionophores (protéines augmentant la perméabilité de la mb à certains ions) a permis une
meilleure compréhension de ces protéines de transport.
On trouve 2 types de protéines:
• Canaux protéiques:
Hormis les canaux de fuite qui sont toujours ouvert, les canaux ioniques ne s'ouvrent que dans certaines
conditions: valeur de potentiel de mb pour les uns, fixation sur un récepteur membranaire associé au
canal, d'un ligand extracellulaire spécifique pour les autres.
• Transporteur ou protéine porteuse:
Ces transporteurs, une fois lié à la molécule, vont changer de conformation ce qui permettra le passage
de celle-ci.
3. Transport Actif
Cas des petites molécules
Ce type de transport permet de faire des déplacement à l'encontre du gradient de concentration.
Il fait appel à des transporteurs dont le changement de configuration permettant le passage de la
substance, nécessite de l'énergie, fournit principalement par la dégradation de l'ATP (protéine ATP dépendante).
La présence de protéine fait que ce phénomène est saturable.
Les transporteurs sont alors appelés des gomges.
Transport actifs ATP dépendants
II existe de nombreux exemple chez les Eucaryotes: la pompe à calcium de la mb, la pompe antiport H+/
K+ de la muqueuse gastrique.
• La pompe antiport Na/K ATPase qui expulse le Na de la cellule en échange de K.
Système qui a été très étudié et appelé communément la Pompe Na/K. Elle est constituée de 2 sousunités:
- une sous-unité α non glycosylée de 110 kDa qui a l'activité enzymatique ATPasique
- une sous-unité β glycosylée de 55 kDa
Cette pompe fait entrer dans la cellule des ions K+ et fait sortir des ions Na+.
L'enzyme possède 2 conformations différentes:
E1 : haute affinité pour Na+ orienté vers l'intérieur de la cellule
E2: possède un site de liaison à haute affinité pour K+ du côté extracellulaire.
Les différentes étapes:
1 - E1 fixe 3 Na+ et un ATP pour former un complexe ternaire.
2 - le complexe réagit, et obtention d'un intermédiaire aspartyl~P riche en énergie
3 - l'intermédiaire prend une conformation E2-P faible en énergie et libère hors de la cellule les Na+
4 - E2-P va fixer 2 K+
5 - le groupement phosphate est hydrolyse
6 - E2 redevient E1 après sa libération dans la cellule des K+
Rq : Afin de conserver un potentiel membranaire favorable, les K+ vont s'échapper de la cellule par des
canaux de fuite (diffusion facilitée)
• La translocation de groupe.
C'est une variante des transports actifs ATPase dépendants présent chez les bactéries pour importer
certains sucres. Cette variante diffère du fait que les molécules transportées seront
modifiées chimiquement pendant leur transport souvent une phosphorylation dans le cas des sucres.
Cela a l'avantage de ioniser la molécule et donc de la retenir dans la cellule, ex: le glucose entrera dans
la cellule mais sera transformé en G6P pendant le transfert.
Les transports actifs secondaires
Dans le système précédent (Na/K), l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP est utilisée pour former des
gradients de potentiel électrochimique. Ces gradients sont utilisés ensuite pour permettre d'autre processus endergonique.
Les transport actifs secondaires, eux, fonctionnent par dissipation de ces gradients d'où le terme de secondaire.
ex: la lactose perméase d'EC, la translocase mitochondriale.
• Le Symport Na + /glucose dans Tépithélium intestinal.
Le glc alimentaire est concentré activement par les cellules de la bordure en brosse de l'épithélium
intestinal grâce à un symport Na+ dépendant.
Après avoir traversé la cellule, il ressort de la cellule vers le système circulatoire en utilisant un système
uniport de glucose à diffusion facilitée localisée sur le côté capillaire de ces cellules.
La source énergétique du transport du glucose est uniquement le gradient de Na-. Mais c'est l'hydrolyse
de l'ATP qui permet de maintenir le gradient de Na+.
Rq : Comme le glucose augmente l'entrée de Na+, qui à son tour augmente l'entrée d'eau, c'est la raison
pour laquelle les personnes souffrant de diarrhées sont nourris avec du glucose.
Cas des grosses molécules
Le transport des grosses molécules nécessite toujours de l'énergie et demande une participation d'un
morceau de membrane. La majorité des cellules sont capables de rejeter ou d'absorber des macromolécules à travers leur membrane.
Endocytose:
Des macromolécules peuvent être captées par la cellule après fixation sur certains récepteurs (puits
recouverts), par 2 processus:
Pinocytose: concerne la majorité des cellules lors de l'absorption de fluides, et fait intervenir
des protéines membranaires (dont la clathrine fait partie pour former des « puits recouvert »)
rassemblées en des endroits de la membrane et qui vont fixer les substances à ingérer. Cela permet
d'absorber un maximum de substances sans pour autant absorber un grand volume de liquide. Les
vésicules de pinocytose fusionneront ensuite en général avec des lysosomes, mais parfois n'auront
qu'un rôle de transport jusqu'à un autre organites..
Phagocytose: ne concerne que certaines cellules (neutrophiles, macrophages...) capable
d'ingérer de grosses particules. Cela fait intervenir des mouvements membranaires avec émissions de
pseudopodes englobant la particule étrangère, et donne naissance à une vésicule de phagocytose de
grosse taille (d'où le nom de vacuole de phagocytose) qui fusionnera également avec un lysosome.
Exocytose:
Il s'agit d'un phénomène similaire, à ceci près que c'est la cellule qui excrète vers l'extérieur des
substances bien souvent néosynthétisées par le RE et le Golgi.
Les substances sécrétées sont souvent stockées dans des vésicules de sécrétion, en attendant un
signal souvent d'origine chimique (hormone) qui se fixera sur la mb ce qui provoque une augmentation
de [Ca2+] dans la cellule ce qui amorce l'exocytose en favorisant la fusion des vésicules sécrétrices et la mb.
On distingue 2 types d'exocytose:
l'exocytose constitutive, qui existe dans toutes les cellules et qui correspond au déplacement
constant de vésicules provenant des dictyosomes vers la mb. Cela permet un renouvellement de la mb
et la libération du contenu de la vésicule dans le milieu extérieur.
l'exocytose provoquée, qui ne concerne que les cellules sécrétrices (cellules glandulaires,
neurones) mais qui doivent être stimulées pour libérer le contenu de leurs vésicules stockées dans le cytosol.